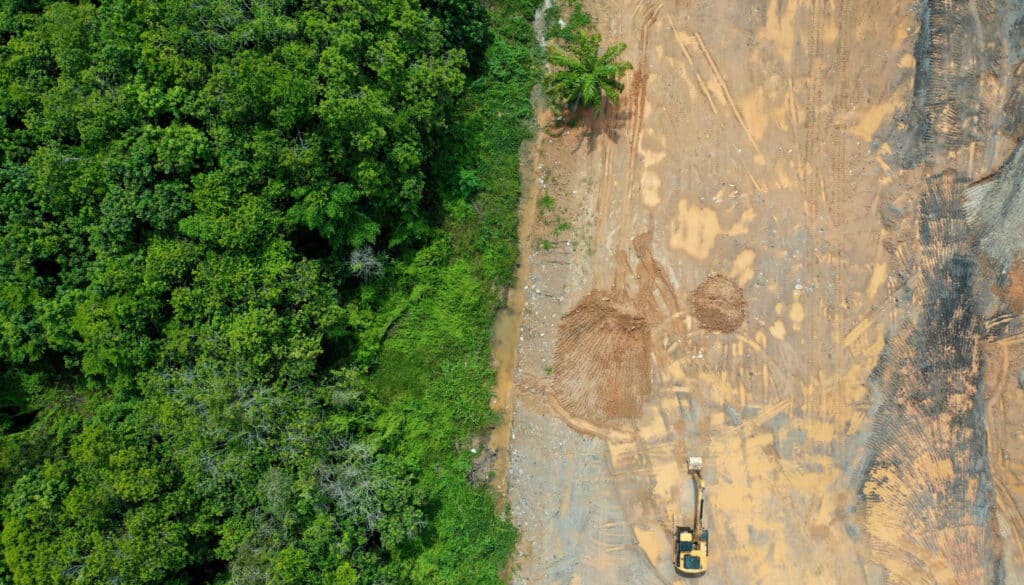Étapes clés pour la mise en œuvre du devoir de diligence des entreprises
Le goodblog | read time: 11 min
Published: 7 avril 2025
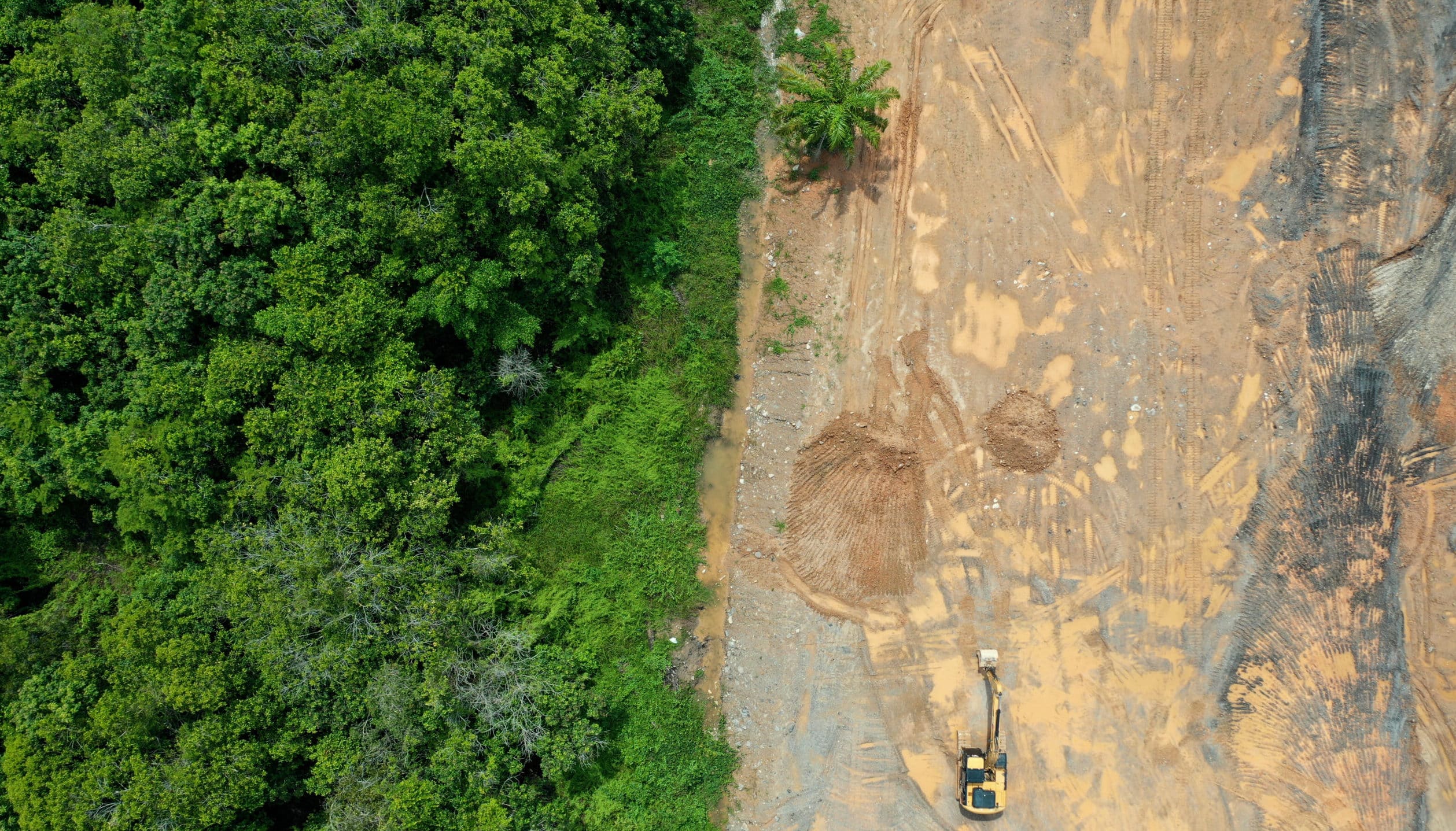
Maintenant que la directive européenne sur le devoir de diligence des entreprises en matière de durabilité (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD) est en vigueur, il est temps d’examiner de plus près les obligations qu’elle impose, en particulier ce que l’on entend par devoir de diligence des entreprises.
En vertu de la nouvelle directive, les entreprises concernées ont désormais l’obligation d’identifier et de traiter les incidences négatives, réelles et potentielles, sur les droits humains et l’environnement, non seulement dans leurs propres activités, mais aussi dans les filiales et chez les partenaires commerciaux qui composent leur « chaîne d’activités ». Celle-ci est définie comme étant les filiales et les partenaires impliqués dans la production de biens ou la fourniture de services, ainsi que les entreprises impliquées dans la distribution, le transport et le stockage des produits.
Qu’entend la CSDDD par diligence raisonnable en matière de droits humains et d’environnement ?
Dans le monde des affaires, la diligence raisonnable est généralement comprise comme les contrôles détaillés effectués sur une entreprise avant de conclure un accord ou un arrangement financier. Traditionnellement, cela implique un examen rétrospectif des rapports d’entreprise, des bilans, des performances du marché et d’autres informations accessibles au public afin de prendre des décisions éclairées.
Cependant, la diligence raisonnable en matière de droits humains et d’environnement, telle que définie dans la directive, adopte une approche très différente. En utilisant la définition de la diligence raisonnable du Guide OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises, la directive impose une série d’obligations spécifiques. Il ne s’agit pas seulement d’identifier les problèmes réels et potentiels, comme cela pourrait être le cas avec une diligence raisonnable plus traditionnelle, mais aussi de développer des mesures appropriées pour traiter, prévenir, atténuer et corriger les impacts négatifs constatés.
Ainsi, un processus continu est nécessaire, et il doit être intégré dans des systèmes plus larges de gestion des risques de l’entreprise, de la même manière que d’autres mesures réglementaires telles que les mesures de lutte contre la corruption, de santé et de sécurité et de prévention de la fraude ont été incorporées.
Les obligations précises sont énoncées à l’article 5, mais surtout, la directive précise que les entreprises doivent adopter une approche fondée sur les risques pour leurs obligations de diligence raisonnable. Cela signifie qu’elles doivent hiérarchiser les actions en fonction de leur gravité et de leur probabilité, en reconnaissant qu’il ne sera peut-être pas possible de traiter tous les impacts simultanément.
En quoi la diligence raisonnable de la CSDDD diffère-t-elle de la diligence raisonnable traditionnelle des entreprises ?
Quatre éléments clés distinguent les exigences de diligence raisonnable telles que définies dans la directive de ce que l’on entend habituellement par diligence raisonnable.
Premièrement, en vertu de la directive, les entreprises sont tenues d’examiner l’avenir ainsi que le passé, en identifiant les impacts négatifs potentiels ainsi que réels. Si la préparation aux chocs futurs est la pierre angulaire d’une bonne gestion des risques d’entreprise, l’identification et la gestion des éventuels impacts négatifs sur les droits humains et l’environnement nécessiteront probablement une nouvelle approche et, pour certaines organisations, de nouvelles compétences.
Deuxièmement, le processus de diligence raisonnable décrit dans la directive met l’accent sur l’engagement des parties prenantes. Contrairement à la diligence raisonnable plus standard des entreprises, qui repose sur des preuves documentées, la directive exige une consultation significative de toutes les parties prenantes concernées, y compris les travailleurs, la direction, les groupes communautaires, les représentants des travailleurs et les organisations de la société civile. Là encore, cela s’aligne sur l’approche de la diligence raisonnable définie dans le Guide de l’OCDE sur le devoir de diligence des entreprises. Ce n’est qu’en consultant les parties prenantes potentiellement concernées que les entreprises peuvent évaluer avec précision leurs impacts sur les droits humains et l’environnement et identifier correctement les mesures de prévention et d’atténuation nécessaires.
Troisièmement, la directive stipule que la diligence raisonnable doit être axée principalement sur les incidences négatives sur les personnes et la planète, l’impact sur l’entreprise étant une considération secondaire, mais néanmoins importante.
Enfin, contrairement à la diligence raisonnable plus traditionnelle qui est en fait un exercice de collecte d’informations, la directive impose non seulement l’obligation de traiter et de remédier à toute incidence négative constatée, mais aussi des sanctions importantes en cas de manquement à cette obligation. Cela incite clairement les entreprises à résoudre les problèmes qu’elles identifient, ce qui n’est pas toujours le cas à l’issue d’un exercice de diligence raisonnable.
Mettre en œuvre la diligence raisonnable de la CSDDD
La directive énumère huit actions spécifiques que les entreprises concernées devront mener à bien afin de se conformer à l’obligation de diligence raisonnable des entreprises. En nous appuyant sur notre expérience d’aide aux entreprises pour gérer et atténuer leurs impacts négatifs, nous identifions ce que cela est susceptible de signifier dans la pratique.
1. Intégrer la diligence raisonnable dans les politiques d’entreprise et les systèmes de gestion des risques
Il s’agit d’une exigence importante pour les entreprises et qui impliquera un certain nombre d’étapes importantes si elle doit être correctement réalisée.
Une bonne façon de commencer est de procéder à une analyse des écarts entre les politiques et procédures existantes en matière de droits humains et d’environnement par rapport aux normes reconnues du secteur et aux meilleures pratiques des entreprises. L’analyse des écarts doit se concentrer sur les éléments clés nécessaires à la mise en place d’un système de gestion rigoureux de la diligence raisonnable. Cela devrait inclure des pratiques telles que la gouvernance des droits humains et la diligence raisonnable en matière d’environnement, l’engagement des cadres supérieurs dans la mise en œuvre ainsi que l’élaboration et la gestion des politiques. L’utilisation d’un cadre tel que le cadre de GoodCorporation sur les droits humains et la diligence raisonnable en matière d’environnement peut aider à garantir que tous les domaines pertinents sont inclus.
Les entreprises pourraient également envisager de comparer leurs politiques, pratiques et procédures à celles de leurs pairs du secteur et des entreprises les plus performantes en utilisant les exigences clés de la directive comme critères de comparaison.
Une évaluation comparative par rapport aux pairs du secteur peut être un outil puissant pour impliquer les cadres supérieurs dans le processus et peut aider à garantir l’allocation appropriée des ressources pour mettre en œuvre les programmes nécessaires. Les données de l’évaluation comparative peuvent également être ajoutées à l’analyse des écarts et utilisées pour informer le plan d’action des étapes nécessaires à l’élaboration des politiques et des systèmes de gestion requis.
La priorité devrait être donnée à l’élaboration d’une politique de diligence raisonnable qui définisse les étapes nécessaires pour identifier, traiter et remédier aux incidences négatives, réelles et potentielles, sur les droits humains et l’environnement.
Deux écoles de pensée émergent quant à la forme que devrait prendre une telle politique. Il pourrait s’agir d’une politique de diligence raisonnable autonome axée sur les droits humains et les questions environnementales. Les exigences de diligence raisonnable de la directive pourraient également être intégrées dans les politiques existantes en matière de droits humains et d’environnement. Cette approche serait conforme au guide de l’OCDE sur la conduite responsable des entreprises, qui recommande de combiner les plans d’une entreprise pour la mise en œuvre d’une telle diligence raisonnable fondée sur les risques avec les politiques existantes.
Les entreprises qui n’ont pas de politique en matière de droits humains ou d’environnement devraient chercher à en élaborer une et veiller à y inclure les exigences nécessaires en matière de diligence raisonnable.
2. Identification des incidences négatives sur les droits humains et l’environnement
La première étape pour identifier les incidences négatives réelles et potentielles sur les droits humains consiste à cartographier les risques afin de déterminer tous les domaines où les incidences négatives sont les plus susceptibles de se produire et d’être les plus graves, non seulement dans le cadre de vos propres activités, mais aussi dans celles des filiales et des partenaires commerciaux concernés.
Une fois les risques compris, il sera important de procéder à des évaluations approfondies de ces risques afin d’en déterminer la portée, l’ampleur, la possibilité de remédiation et la probabilité. Pour ce faire efficacement, les entreprises devront être conscientes des nombreux impacts négatifs sur les droits humains et l’environnement qui peuvent se produire, des lieux, secteurs et industries à haut risque qui font partie de leurs activités, et des parties prenantes qui peuvent fournir des informations précises et pertinentes.
3. S’engager avec les parties prenantes
Une consultation significative des parties prenantes est un élément essentiel de ce nouveau devoir de diligence raisonnable des entreprises. Elle renforce l’un des principes clés de la législation, à savoir que l’accent est mis sur les impacts sur les personnes et la planète plutôt que sur l’entreprise elle-même. Cet élément des exigences de diligence raisonnable s’appuie sur les directives des Principes directeurs des Nations unies, qui estiment que ce n’est qu’en consultant les parties prenantes concernées que les risques et les impacts peuvent être correctement compris, atténués et corrigés.
Cette consultation doit faire partie du processus de collecte d’informations et sera nécessaire pour alimenter le plan d’action à venir. Il sera important de déterminer soigneusement les principales parties prenantes, idéalement par le biais d’un exercice de cartographie, en veillant à ce qu’un échantillon représentatif de parties prenantes soit inclus afin de garantir la crédibilité des informations reçues. Le cas échéant, il peut être avantageux d’inclure des ONG, des représentants des travailleurs et les autorités compétentes afin de donner une image vraiment précise des questions à traiter. Il peut arriver qu’il soit impossible d’obtenir suffisamment d’informations de la part des parties prenantes concernées, auquel cas un groupe d’experts doit être constitué pour obtenir les preuves nécessaires.
Une fois les parties prenantes identifiées, la portée de la consultation peut être convenue et le processus mis en œuvre, en veillant à garantir la confidentialité si nécessaire et à ce que les participants ne fassent l’objet d’aucune forme de représailles.
4. Élaboration et mise en œuvre d’un plan d’action pour des améliorations
Une fois que tous les risques ont été identifiés et compris, il convient d’envisager et de planifier des mesures de prévention, d’atténuation et de correction. Il est peu probable que tout puisse être traité simultanément, c’est pourquoi il convient de s’attaquer en priorité aux impacts les plus graves et les plus probables.
Le CSDDD exige des entreprises qu’elles prennent des « mesures appropriées » pour remédier à tout impact négatif sur les droits humains et l’environnement. Cela implique de comprendre le niveau d’implication de l’entreprise dans la cause ou la contribution à l’impact ainsi que la capacité de l’entreprise à influencer le partenaire commercial à l’origine ou co-responsable du préjudice.
Une fois ces étapes identifiées, un plan d’action est nécessaire pour définir les mesures préventives et/ou correctives mises en place, avec des calendriers clairement définis, des indicateurs qualitatifs pour mesurer les améliorations et, surtout, des responsables désignés avec des responsabilités attribuées.
Les entreprises devront travailler en étroite collaboration avec leurs partenaires commerciaux pour s’assurer que tous sont alignés sur les objectifs d’amélioration. Un programme de renforcement des capacités peut aider à fournir le soutien adéquat tout au long de la chaîne d’activités. En outre, des garanties contractuelles de la part des entreprises peuvent être nécessaires, incluant idéalement une forme de vérification de la conformité, éventuellement en faisant appel à un tiers indépendant. Il peut également être nécessaire d’envisager des actions collectives avec d’autres acteurs du même secteur afin d’utiliser un effet de levier combiné pour opérer le changement.
Certaines de ces mesures peuvent nécessiter des ajustements importants des pratiques commerciales et devront être intégrées dans les procédures opérationnelles et l’infrastructure avec des investissements et une formation appropriés pour garantir leur efficacité. Une partie de cet investissement peut également être nécessaire pour les partenaires commerciaux, car la directive prévoit que les entreprises concernées apportent un soutien financier aux PME partenaires dont la viabilité pourrait être compromise par leur mise en conformité avec la directive CSDDD.
5. Garantir des canaux de communication appropriés
En vertu de la directive, la diligence raisonnable est un processus continu plutôt qu’une tâche ponctuelle. À ce titre, un système de recueil des alertes sera nécessaire pour recevoir et traiter les plaintes. Pour de nombreuses entreprises, cela impliquera de revoir le système existant pour s’assurer qu’il est conforme aux exigences de la directive.
Un système de signalement ou d’alerte efficace doit être accessible au public pour permettre aux personnes et aux entreprises de déposer des plaintes concernant vos activités et celles de vos partenaires commerciaux. Il doit être facilement accessible, facile à utiliser et transparent.
Il sera également nécessaire de s’assurer que si un incident pertinent est signalé, il sera traité de manière appropriée par le biais d’un processus de triage, de filtrage et de remontée hiérarchique. Des ressources expérimentées en matière d’enquête seront également nécessaires pour analyser les rapports de manière approfondie afin de déterminer la réponse appropriée.
Enfin, comme pour tout bon système de signalement, il sera important de disposer d’un plan de communication continue avec les parties prenantes concernant la plainte et les mesures mises en place pour éviter toute représailles.
6. Suivi des progrès et des améliorations
Un système de suivi des progrès et de l’efficacité des mesures de prévention ou de réparation mises en place sera essentiel au processus continu. Les entreprises devront déterminer les critères de suivi, y compris les indicateurs de performance ou de progrès, le respect des délais, l’efficacité des mesures correctives et les détails de tout incident nouveau ou émergent.
Le suivi doit être effectué au moins une fois par an par un personnel correctement formé et informé de ce que le processus implique.
7. Évaluer s’il faut se désengager
La directive privilégie l’engagement plutôt que le désengagement, ce dernier n’étant envisagé que dans les cas les plus graves et en dernier recours lorsque les autres mesures ont échoué. Avant de se désengager, les entreprises doivent essayer de mettre en œuvre un plan d’amélioration, en soutenant les partenaires commerciaux de manière appropriée pour renforcer les capacités et la conformité, et en utilisant leur influence autant que possible.
Lorsque ces mesures ont échoué et que le désengagement est envisagé, une entreprise doit évaluer les éventuels impacts négatifs du désengagement et déterminer s’ils pourraient l’emporter sur les impacts négatifs auxquels il est remédié. Si l’entreprise est convaincue que ce n’est pas le cas, le désengagement doit être envisagé à condition que des mesures puissent être prises pour atténuer les éventuels impacts négatifs de la résiliation et qu’un préavis suffisant soit donné.
Conclusion
Non seulement les entreprises concernées sont tenues de respecter ces obligations de diligence raisonnable, mais elles devront également communiquer publiquement sur les mesures prises conformément aux obligations énoncées dans la CSRD et les European Sustainability Reporting Standards.
Si de nombreuses entreprises ont pris des mesures pour évaluer et traiter les éventuelles conséquences négatives de leurs activités sur les droits humains et l’environnement, le respect des obligations spécifiques de la directive, en particulier en ce qui concerne l’extension à la chaîne d’activités, nécessitera probablement un changement de vitesse.
Néanmoins, de nombreuses entreprises ont salué la directive, car elle crée une plus grande sécurité juridique et des conditions de concurrence plus équitables. GoodCorporation travaille avec les entreprises pour les aider à créer une feuille de route vers la conformité CSDDD, en utilisant notre cadre pour les analyses des écarts, l’analyse comparative, l’élaboration de politiques et de stratégies. Pour plus d’informations, contactez un membre de notre équipe.
work with us